|
User-agent:
* DisalloW": |
 |
|
Les
Ateliers
d'Art
Universel |
|
 |
|
|
|
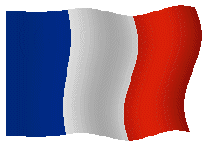 |
Vous
naviguez actuellement
dans
la Section du Site
|
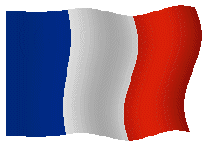 |
|
|
| |
Évangile
selon Saint Matthieu |
|
| . |
. |
|
 |
Précédente |
|
|
 |
Suivante |
|
|
 |
Sommaire |
|
|
 |
Sommaire
des Livres |
|
|
 |
Sommaire
Général |
|
|
 |
Contactez-
nous |
|
|
 |
Accueil |
|
|
|
|
|
.
|
|
|
La Porte du
Ciel N° Matth. 03
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
 |
 |
| . |
|
|
| |
| . |
. |
|
|
| |
. |
|
|
|
"ÉVANGILE
et LES QUATRE ÉVANGILES .
|
| |
. |
|
|
| |
. |
|
|
| |
|
| L |
| E
terme '"Évangile ",
transcrit du grec euaggélion
qui, dans la |
| langue
classique,
signifie '"récompense ou
action de grâces |
| pour
une "bonne
nouvelle", prit tout
naturellement le sens |
|
| deuaggélia
: la "bonne
nouvelle" elle même; il
retrouvait ainsi le sens premier que
lui confère l'étymologie. Les
traducteurs grecs de l'Ancien
Testament usent parfois de ce mot,
ou de formes verbales de la même
famille, pour évoquer en certains récits
la transmission d'une information
jugée heureuse par celui qui la
porte ou celui qui l'attend. |
|
|
|
| |
|
. |
|
| |
|
Mais
les mêmes termes prennent une valeur singulière
dans les textes prophétiques qui annoncent le Règne
définitif de Dieu, à travers la restauration
d'Israël et l'avènement de "I'Oint"
messianique (ISAÏE, chap. 40, vers. 9 ; c. 52,
v. 7 ; c. 60, v. 6 ; c. 61, v. 3 ; etc., cf.
MATTHIEU, chap. 11, vers. 5 ; LUC, c. 4, v. 18-19
; etc.). Car c'est cette "Bonne
Nouvelle" par excellence que concrétise la
révélation du grand espoir éveillé par les
prophètes : la venue du Messie, le
"Sauveur qui est le Christ Seigneur"
(LUC, chap. 2, vers. 10-11), et qui précisément
proclame "l'Évangile de Dieu", disant
"Le temps est accompli, et le royaume de
Dieu est proche " (MARC, chap. 1, vers. 14-15).
Ainsi cet "Évangile" est-il, au sens
chrétien, le Message du salut ; avec tous les développements
qu'apporte à sa formulation l'enseignement du
Christ, prêché par les Apôtres (cf. MARC,
chap. 16, vers. 15 ; ROMAINS, chap. 1, v. 1 ;
etc.). |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Chacun
des quatre ouvrages du Nouveau Testament qui
consignent le principal de cet enseignement de Jésus
durant sa vie terrestre est dit à son tour
livre de la "Bonne Nouvelle". On parle
donc des Évangiles de MATTHIEU, de MARC, de LUC
et de JEAN, expressions différentes de l'Évangile
unique. Vraisemblablement réunis dès le II°
s.,
ainsi que nous l'avons signalé plus haut, en recueil qui fait autorité
dans l'ensemble des communautés chrétiennes,
ces Évangiles demeurent les seuls retenus au
"canon" des Écritures. |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Cette
consécration officielle, qui les distingue de
la multitude des "évangiles"
apocryphes (des Égyptiens, des Hébreux, de
Pierre, de Philippe, de Thomas, "protévangile"
de Jacques, etc.), ne tend nullement à les présenter
comme des biographies du Christ absolument complètes,
d'une exactitude minutieuse dans les moindres détails
événementiels ou chronologiques, et rapportant
les propos du Maître avec une précision sténographique.
Comme tous les auteurs sacrés, les quatre Évangélistes
utilisent, chacun à sa manière, leurs
informations personnelles avec celles qu'ils ont
pu recueillir parfois de sources différentes,
et usent des formes et procédés littéraires
en vogue qui leur conviennent. Mais, comme tous
aussi, ils s'attachent à rendre fidèlement le
Message divin, bien plus qu'à définir ou contrôler
avec rigueur les circonstances ou les dates sans
importance pour la signification de ce Message.
Et c'est bien l'authenticité divine de la
"Bonne Nouvelle" ainsi transmise dans
sa teneur substantielle, que garantit l'adhésion
unanime de la tradition chrétienne ancienne et
constante,
confirmée par l'engagement formel
de l'autorité conférée par le Christ à son
Église. |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Certainement adaptées et complétées à plusieurs reprises selon les
besoins de leurs premiers destinataires du temps
apostolique, et peut-être chargées de quelques
touches tardives qui non seulement n'en dénaturent
pas le sens initial mais en soulignent certaines
valeurs, ces pages capitales de l'histoire du
salut, telles qu'elles nous sont parvenues et en
dépit de légères discordances apparentes,
s'accordent ou se complètent sur l'essentiel : elles témoignent bien de l'existence historique de Jésus, le Fils de Dieu
fait homme, de ses actes et de ses paroles.
|
|
| |
. |
|
|
| |
|
Qu'elles témoignent aussi de l'interprétation des faits et dits du Christ
telle que la proposèrent les Apôtres éclairés
par l'Esprit-Saint, et qu'elles reflètent la
foi chrétienne des tout premiers âges de l'Église,
ne peut qu'ajouter à leur prix au regard du
croyant comme de l'historien. |
|
| |
. |
|
|
| |
|
LES
SYNOPTIQUES |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Il
n'échappera à aucun lecteur que, des quatre Évangiles,
chacun des trois premiers (MATTHIEU, MARC et
LUC) tient trop des deux autres pour être considérés comme totalement indépendant
dans le témoignage qu'il porte. Que l'objet de
ce témoignage soit bien sûr le même, ne
suffit pas à expliquer l'emploi massif de matériaux
communs jusque dans une forme élaborée. Or, on
dénombre quelque trois cent trente versets
identiques en substance dans les trois livres;
ils fournissent la moitié du texte de MARC, un
tiers environ de celui de MATTHIEU et de LUC. En
outre, près de deux cents versets de MARC se
retrouvent à peu près en MATTHIEU seulement,
et une centaine en LUC ;tandis que plus de deux
cents, étrangers à MARC, sont communs à
MATTHIEU et à LUC. |
|
| |
.. |
|
|
| |
|
L'étroite parenté des trois livres apparaît encore dans l'adoption du même
plan d'ensemble, dont l'esquisse semble empruntée
à la prédication de Pierre (cf. ACTES, chap.
10 vers. 37-41) : 1° Préparation du ministère
public de Jésus (MATTHIEU, chap. 3 à chap.
4, vers. 11 ; MARC, chap. 1 vers. 1-13 ; LUC,
chap. 3
à chap. 4, vers. 13) --- 2° Ministère exercé en Galilée ou
à partir de la Galilée (MATTHIEU, chap. 4, vers. 12 à chap. 18 ; MARC, chap.
1 vers. 14 à chap. 9; LUC, chap. 4, vers. 14 à
chap. 9, vers. 50; --- 3° Montée vers Jérusalem
(MATTHIEU, chap. 19 et chap. 20 ; MARC, chap. 10
:
LUC, chap. 9, vers. 51 à chap. 19, vers. 28) --- 4° Ministère à Jérusalem,
Passion et Résurrection (MATTHIEU, chap. 21 à
chap. 28 ; MARC, chap. 11 à chap. 16 ; LUC,
chap. 19 vers. 29 à chap. 24).
|
|
| |
. |
|
|
| |
|
Enfin les experts relèvent, dan les trois livres encore, des citations
semblables de l'Écriture ancienne sous une
forme qu n'est cependant ni celle de l'hébreu,
ni celle de la Septante que l'on rencontrerait
ici ou là sans surprise ; et surtout ils
soulignent l'usage de mêmes mots grecs, parfois
rares, pour rendre des propos manifestement
tenus en araméen. La fréquence relative de
telles options communes rendrait fort improbable
qu'elles soient le fait d'auteurs qui
travailleraient en s'ignorant l'un l'autre,
exploitant seulement leurs propres souvenirs ou
ceux qu'ils auraient personnellement recueillis
de diverses traditions orales. |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Mais si les ressemblances entre les témoignages de MATTHIEU, MARC et LUC
apparaissent pour la plupart au premier examen,
une lecture attentive permet de constater aussi
des différences notables.
|
|
| |
. |
|
|
| |
|
Sans
doute la plus apparente tient-elle à la quantité
des faits et paroles rapportés. Ainsi MATTHIEU
et LUC (chap. 1 et 2) sont-ils seuls à rendre
compte des circonstances de la nativité et d'événements
marquants de l'enfance de Jésus ; encore le
font-ils en mettant en valeur des données complémentaires.
Tandis que MARC ouvre directement son Évangile
sur la première partie du plan commun. Bien
d'autres séquences de l'histoire évangélique,
paraboles, paroles du Crucifié, apparitions de
Jésus ressuscité par exemple, ne sont attestées
que par un ou deux seulement des trois. Et si
leurs rapports, notamment sur les plus grands
moments de la vie du Christ, sont dans
l'ensemble concordants, il arrive que les récits,
ou les relations faites des paroles mêmes du Maître,
divergent dans le détail. Parfois enfin les matériaux
communs sont, de l'un à l'autre, autrement
regroupés, ou même autrement distribués entre
les divers volets du plan
par tous respecté en ses grandes lignes. Il va de soi que chacun les
exploite aussi en fonction des besoins, des
aptitudes, des dispositions et connaissances
acquises du public qu'il souhaite d'abord
toucher. |
|
| |
. |
|
|
| |
|
De longue date les meilleurs esprits se sont employés à dresser des
tableaux comparatifs où se lisent d'un seul
regard les références aux passages concernant
de manière évidente ou probable les mêmes événements
ou les mêmes enseignements, dans ces trois
livres si nettement apparentés en dépit de
tels écarts. Les travaux de cette nature qui,
de plus en plus objectivement, tendent à faire
apparaître aussi bien les divergences (rarement
inconciliables sur les points de quelque
importance) que les concordances (sur
l'essentiel), sont connus depuis deux siècles
sous le nom de ''Synopse'' (du grec Synopsis :
"vue d'ensemble") ; et les Évangiles
qui en sont l'objet sont en conséquence appelés
"Synoptiques". |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Le constat ainsi établi invitait à chercher d'où viennent et comment se
nouent les liens qui unissent ces Synoptiques.
Problème assurément plus complexe que celui de
l'originalité de chacun. Laquelle est tout
naturellement due à la personnalité bien marquée
des auteurs --- "le style est l'homme même"
; et l'homme s'impose d'ailleurs à travers tous
ses choix de genre ou de composition ---, mais
aussi à la fidélité plus ou moins sensible au
détail de sa propre mémoire ou de la mémoire
d'autres témoins qui contribuent plus
directement ou plus complètement à son
information qu'à celle des autres Évangélistes. |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Quant
à l'information commune, le fonds ne saurait être
que la tradition la plus autorisée et la plus largement répandue, née de
tous ceux qui approchèrent le Christ sur la
terre, et dont probablement d'importantes
données, peut-être très tôt groupées par
sujets, se trouvent déjà fixées par écrit en
araméen ou en grec lorsque sont rédigés les
textes que nous connaissons. |
|
| |
. |
|
|
| |
|
Un premier "Évangile de Matthieu", aujourd'hui disparu, essai
composé en araméen et sans doute partiellement
traduit en grec dans les années 50-60, pourrait
être un des principaux, sinon le principal
parmi ces documents présynoptiques. La plupart
des experts estiment aujourd'hui que MARC (daté
des années 6570 ?), produit direct de l'Évangile
prêché par Pierre, ne leur doit guère. Mais
MATTHIEU, dans le texte grec qui est le nôtre,
ainsi que LUC (datés, eux, des années 70-80
?), ont emprunté à MARC en même temps qu'au
premier "essai" de Matthieu déjà
partiellement traduit, ou à d'autres documents
grecs de même époque groupant des éléments
de la catéchèse apostolique en Orient. |
|
| |
é |
|
|
| |
|
C'est en tout cas, très schématiquement exposée, une hypothèse
raisonnable, fondée sur l'étude critique des
textes, et qui explique à la fois l'apparente
dépendance mutuelle de MATTHIEU et de LUC aussi
bien que leur commune dépendance de MARC. |
|
| |
.é |
|
|
| |
|
Quoiqu'il
en soit, issus tous trois, par le canal de
"présynoptiques" ou non, de la source
même d'où jaillit la Bonne Nouvelle, les
Synoptiques --- qui s'éclairent l'un l'autre
--- sont bien authentiques leçons de "l'Évangile
du Christ". |
|
| |
|
|
|
|
|
Les
images et les textes proviennent de : en ce temps là la
bible. Éditions
du Hennin Paris 1977
. |
|
|
|
| . |
|
Voici le meilleur Site pour former
et fortifier l'esprit.
Voici le meilleur Site
pour franchir La Porte du Ciel allègrement.
Que
l'Éternité doit être longue si nous la passons ailleurs qu'au «
Ciel »!
Ce
merveilleux endroit
que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, nous a
promis.
Papy
pour vous Servir
Haut de la page
œ
|
|
|