|
User-agent:
* DisalloW": |
 |
|
Les
Ateliers
d'Art
Universel |
|
 |
|
|
|
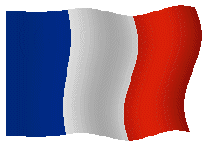 |
Vous
naviguez actuellement
dans
la Section du Site
|
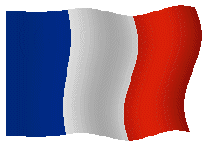 |
|
|
| |
Évangile
selon Saint Matthieu |
|
| . |
. |
|
 |
Précédente |
|
|
 |
Suivante |
|
|
 |
Sommaire |
|
|
 |
Sommaire
des Livres |
|
|
 |
Sommaire
Général |
|
|
 |
Contactez-
nous |
|
|
 |
Accueil |
|
|
|
|
|
.
|
|
|
La Porte du
Ciel N° Matth. 04
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
 |
 |
| . |
|
|
| |
| |
. |
|
| |
. |
|
|
MATTHIEU
: Évangile du "Messie promis" |
| |
. |
|
| |
. |
|
| |
| C |
| EST
bien à MATTHIEU, "Apôtre
de Jésus-Christ",
que |
| l'Église
des premiers siècles
reconnaît le mérite
d'avoir
|
| avant
tout autre regroupé et mis en
ordre les
"Paroles |
|
| (du
Seigneur)" dans un ouvrage
assez complet et sous une forme
suffisamment élaborée pour qu'on
parlât d'un "Évangile "
; les témoignages connus de maints
personnages illustres (Papias, Irénée,
Tertullien, Clément d'Alexandrie,
Origène, Eusèbe...) garantissent
le fait ou le supposent acquis. Sans
doute l'écrit araméen perdu très
tôt, mais probablement devenu dans
une version grecque l'une des
principales sources des Synoptiques,
vaut-il à son auteur d'être fort
justement tenu pour le premier Évangéliste.
Titre confirmé par la place
traditionnellement accordée, en tête
du Nouveau Testament, à l'Évangile
qui porte son nom ; même si, comme
il y paraît, cet " Évangile
de MATTHIEU" est en fait postérieur
à celui de MARC dont il tire
apparemment, nous l'avons signalé
plus
haut, une part de sa substance,
surtout dans les récits. |
|
|
|
| |
. |
|
| |
. |
|
| |
En
tout état de cause, MATTHIEU, tel qu'il est
admis au canon de l'Écriture chrétienne, ne se
présente pas comme une traduction, mais plutôt
comme une œuvre
bel et bien composée en grec. Tout porte
cependant à croire que son
rédacteur
dispose du " premier Évangile " en
langue araméenne et, plus sûrement, qu'il réemploie,
en les adaptant ou non selon les besoins de la
nouvelle composition, des textes qui en sont déjà
traduits et diffusés en langue grecque. Ce rédacteur,
qui travaille vraisemblablement aux environs de
l'an 70, est-il l'apôtre Matthieu lui-même ou
quelque autre qu'il a pu contrôler et
approuver? Aucun argument absolument convaincant
n'exclut la première hypothèse, malgré que
certains modernes la considèrent comme la moins
probable, sans d'ailleurs mettre en doute
l'authenticité scripturaire du livre, attestée,
déjà par l'usage qu'en font les Pères
apostoliques, la Didachè ("Enseignement
[des 12 Apôtres] ", traité destiné à la
formation des catéchumènes), et les premiers
apologistes du II°s.
|
|
| |
. |
|
| |
Au
demeurant, pourquoi le publicain de Capharnaüm,
percepteur de péage ou d'octroi lorsqu'il fut
appelé par 1e Christ, et certainement bilingue
par nécessité de fonction, ne serait-il pas
pleinement l'auteur du texte grec comme de l'araméen ? |
|
| |
. |
|
| |
La modestie de cet homme que le premier Évangile (chap. 9, vers. 9) nomme
d'emblée Matthieu ("don de Dieu",
peut-être un surnom reçu ultérieurement au
sein du collège apostolique ; cf. chap. 10,
vers. 3 ; MARC, chap. 3, vers. 18 ; LUC, chap.
6, vers. 15), expliquerait qu'il ne se désigne
pas lui-même sous le nom cérémonieux et
flatteur de Lévi dont usent MARC (chap.
2, vers. 14) et LUC (chap. 5, vers. 27 et 29) en
relatant la vocation du "collecteur d'impôts".
Une inclination naturelle différente de celle
de Pierre, par exemple, dont MARC recueille le témoignage
si vivant, suffirait aussi à expliquer que, témoin
comme le prince des apôtres de la vie publique
du Christ, il ait été plus sensible aux propos
du Maître et à la portée de ses actes
significatifs qu'au détail de faits et gestes.
Quant au ton général de l'ouvrage, jugé
parfois trop solennel pour être celui d'un
"témoignage vécu", et vécu
personnellement par qui le porte, il n'a rien de
tellement surprenant si le témoin a un sens
aigu du respect sacré que mérite ce dont il
rend compte.
|
|
| |
. |
|
| |
Bien plus : ce respect extrême du sacré chez un tel témoin, joint à
l'attention particulière que nous lui supposons
pour les propos te
nus en sa présence, fût-ce au détriment de
l'observation des circonstances et des
personnages, fait peut-être souvent de MATTHIEU
le plus fidèle à rapporter les paroles exactes
prononcées par le Christ, là où les divers Évangiles
en restituent la teneur avec de menues
variantes. |
|
| |
. |
|
| |
Un
Juif, qui s'adresse d'abord aux juifs |
|
| |
.. |
|
| |
Qu'il soit ou non le "publicain de Capharnaüm devenu l'un des
"Douze", l'auteur de ce livre est un
juif, et il écrit d'abord pour des Juifs,
convertis ou à convertir. Dans un grec un peu
rocailleux sans grand éclat ni grandes finesses
mais d'un niveau correct dans la Koinê littéraire
(langue "commune" de l'époque
romaine), il s'exprime en sémite, usant plus
que MARC et LUC d'expressions, formules
stylistiques, figures de construction et de pensées,
nettement typées. Il n'est jusqu'à son recours
singulièrement fréquent à la fascination de
certains nombres qui n'ait été relevé comme
indice du génie de sa race : ainsi comptet-il 7
demandes dans le Pater (MATTHIEU, chap. 6, vers.
9-13), 7 paraboles dans le chapitre 13, ou 7 malédictions
contre les scribes et les pharisiens (chap. 23,
vers. 13-32) avant qu'un verset (v. 14)
transporté
de MARC (chap. 12, vers. 40) ne vienne perturber
le compte, etc. ; et il relèvera même que le
pardon doit être accordé "70 fois 7
fois" (MATTHIEU, chap. 18, vers. 22). 3 et
2 paraissent également chez lui nombres privilégiés
: ainsi des 3 tentations du Christ par le diable
(cf. chap. 4, vers. 3, 5-6, 8-9) ou de ses 3 prières
au jardin de Gethsémani (cf. chap. 26, vers.
39, 42, 44), etc. ; des 2 possédés du pays des
Gadaréniens (chap. 8, vers. 28) ou des 2
aveugles de Jéricho (chap. 20, vers. 30), alors
que dans les deux cas MARC (cf. c. 5, v. 2 ; c.
10, v. 46) et LUC (cf. c. 8, v. 27 ; c. 18, v.
35) parlent d'un seul... Il est bien d'autres
exemples de cette nature. |
|
| |
. |
|
| |
Mais,
mieux que ces curiosités de forme, le contenu
de MATTHIEU révèle la communion de son auteur
et de ses premiers destinataires en une culture
commune. Usages, coutumes et traditions du judaïsme,
et d'un judaïsme palestinien, sont tout
naturellement évoqués, sans le commentaire
qu'appellerait l'ignorance de lecteurs non-initiés.
Et cela, même s'il s'agit de rites purement
rabbiniques, tel que le lavement des mains avant
le repas (cf. MATTHIEU, chap. 15, vers. 2), de
pratiques pharisaïques telle l'ostentation de
houppes au manteau et de phylactères démesurés
(cf. chap. 23, vers. 5), ou d'applications
particulières des ordonnances mosaïques comme
celle qui explique la discrétion de l'hémorroïsse,
frappée d'impureté légale (cf. drap. 9, vers.
20). Fût-ce approximatives, des citations
innombrables (on en relève une douzaine
d'identifiables rien que dans les quatre
premiers chapitres: chap. 1, vers. 23 ; c. 2, v.
6, 15, 18 et 20 ; c. 3, v. 3 ; c. 4, v. 4, 6, 7,
10, 15-16) sollicitent manifestement des
familiers de l'Écriture ancienne. Parfois les
allusions exigent, pour être comprises, une très
solide formation biblique en plus d'une bonne
connaissance du milieu palestinien au l° s. ;
et tant, que les meilleurs spécialistes débattent
toujours, par exemple, sur la référence aux
"Prophètes" qui justifierait le jeu
de mots du dernier verset du chapitre 2 : entre
Nazareth et Nazaréen ou Nazôréen, terme péjoratif
qui orienterait vers les textes prophétiques
annonçant un Messie méprisé et humilié (cf.
ISAÏE, chap. 49,
vers. 7 ; c. 50, v. 6, etc.) ; et peut-être, en
transposant du grec à l'hébreu, entre Nôsry
("Nazaréen") et Néser
("rejeton", ce qui renverrait au
"rameau issu de la tige de Jessé" :
le "roi de justice" qu'est aussi le
Messie promis ISAÏE, chap. 11). |
|
| |
. |
|
| |
Et
c'est en effet ce Messie inaugurant son Royaume
que MATTHIEU se propose avant tout de montrer
dans le Christ Jésus, "Fils de David"
(chap. 1, vers. 1, cf. vers. 20 ; c. 9, v. 27 ;
c. 12, v. 23, etc.), "Fils de l'homme"
(c. 9, v. 6 ; c. 10, v. 23 ; c. 11, v. 19 ; cf.
DANIEL, c. 7, v. 13, mais c'est là une dénomination
nettement messianique au temps de Jésus),
"Fils de Dieu" (MATTHIEU, chap. 4,
vers. 3 ; c. 8, v. 29 ; c. 14, v. 33 ; c. 7 6,
v. 16 ; etc.; cf.. c. 3, v. 17 ; c. 11, v. 27 ;
etc.) ; et il entend le faire pour les lecteurs
"de toutes les nations" sans doute,
mais d'abord en confirmant dans leur foi ses frères
de l'Ancienne Alliance qui ont déjà reconnu
dans le crucifié du Golgotha ressuscité, le
vrai "roi" qu'attendait Israël, et en
interpellant ceux qui, ayant comme eux reçu
"les prophètes, les sages et les
scribes" (cf. drap. 23, vers. 34) annonçant
son avènement, continuent à les persécuter en
leurs successeurs, prédicateurs de l'Évangile,
au lieu de les entendre. |
|
| |
. |
|
| |
"Le
Livre "de la continuité" |
|
| |
. |
|
| |
On
comprendra dès lors que son souci constant de
souligner tout ce qui dans la vie entière de jésus,
de sa naissance à sa mort rédemptrice,
"accomplit les Écritures'', domine celui
d'ordonner rigoureusement dans l'espace et le
temps chaque phase ou épisode de cet
accomplissement. On comprendra encore qu'il
s'applique à rendre évidente la présence du
Dieu d'Israël en "son Christ",
manifestée par l'exercice de la Toute-puissance
divine, mieux qu'à rendre compte de ce qui
n'ajoute pas à la crédibilité de ses
miracles. On comprendra enfin que les récits
tiennent en MATTHIEU moins de place que la prédication
du "Royaume des cieux" --- expression
qui lie le règne messianique à l'accueil des
justes dans la vie éternelle, espérance elle
aussi affirmée au terme de
la Révélation acquise dans l'ère ancienne
(cf. DANIEL, chap. 12, vers. 2; 2 MACCABÉES,
c.7, v.9). |
|
| |
. |
|
| |
Ainsi
a-t-on pu dire qu'entre tous son témoignage
est, de l'un à l'autre Testament, "le
Livre de la continuité", qui sous les
fleurs et les fruits du second découvre des
racines et des semences enfouies dans le
premier. |
|
| |
. |
|
| |
Son
dessein cependant n'incite l'auteur à aucune
complicité dans l'entretien de faux espoirs sur
un accès humainement triomphant au
"Royaume", tel que l'imaginent la
plupart de ses contemporains, voire les
disciples avant leur confirmation dans l'Esprit
(MATTHIEU, chap. 18, vers. 1 ; c. 20, v. 21 ;
MARC, c. 9, v. 34 ; c. 10, v. 37 ; LUC, c. 9, v.
46 ; JEAN, c. 6, v. 15 ; ACTES, c. 1, v. 6) ; il
ne manifeste non plus aucune indulgence pour les
prétentions du judaïsme à assumer à jamais
un monopole de péage sur la voie du salut. |
|
| |
. |
|
| |
Entre
tous encore, MATTHIEU met en belle lumière
l'enseignement de " la porte étroite"
qui mène à ce Royaume et à ce salut par la
pratique de l'humilité et l'acceptation de la
souffrance (MATTHIEU, chap. 5, vers. 3-12 ; c.
7, v. 13-14 ; c. 10, v. 37-39 ; etc.) ; mais il
retient que cette porte est grande ouverte à
"la nation" qui "fera fruit"
du Royaume de Dieu, ôté aux obstinés qui en
captent l'héritage en supprimant l'héritier
(chap. 21, vers. 43). Et comment ne pas voir le
Nouvel et véritable Israël qu'est ]'Église
universelle, dans cette "nation" appelée
de celles "de toute la terre", selon
l'ordre du Christ que rapporte avec insistance
le premier Évangéliste (chap. 24, vers. 14 ;
c. 28, v. 19). En aucun autre, enfin, n'apparaît
plus nettement le renouveau de la LOI dans la
lettre et l'esprit qu'à travers la première
partie (chap. 5, vers. 17-48) de sa version du
"Sermon sur la montagne" (chap. 5 à
7). En son entier d'ailleurs, ce chef-d'
œuvre
de synthèse --- exercice où excelle l'auteur
de MATTHIEU --- est bien présenté comme le
code évangélique dont la proclamation
consacre, non l'abolition de la "Loi
Ancienne", mais la désuétude de ses
dispositions préparatoires à cette
"Nouvelle Loi", qui est la Loi
parfaite, et la Loi de perfection (cf. drap. 5,
vers. 48). |
|
| |
. |
|
| |
L'enseignement
du Christ en 5 grands "discours" |
|
| |
. |
|
| |
De "l'Évangile de l'enfance" (chap. 1 et 2) dont le propos
enrichit celui de LUC de trois épisodes (visite
des "Mages", massacre des
"Innocents", fuite et séjour en Égypte
:
chap. 2, vers. 1 à 22), jusqu'à "l'Évangile de la Passion et de la Résurrection"
(chap. 26 à 28), où les trois Synoptiques se
retrouvent de plus près et qui comporte aussi
chez lui des notes originales (chap. 27, vers.
62-66 ; c. 28, v. 11-15 et 16-20), MATTHIEU
respecte le plan d'ensemble commun en quatre
volets, détaillé plus haut. Mais il regroupe
l'essentiel de l'enseignement du Christ en cinq
grands "discours", hors la diatribe
d'un autre ton contre les scribes et les
pharisiens (chap. 23).
|
|
| |
. |
|
| |
Le "Sermon sur la montagne'' est le premier, le plus long et le plus
savamment composé. Le second tend à la
formation des messagers de l'Évangile (chap.
10, v. 5-42). Le troisième réunit 7 paraboles
(chap. 13, vers. 1-52), dont quatre (chap. 13,
vers. 24-30 et 36-43 ; v. 44 ; v. 45-46 ; v. 47-50)
ont échappé à MARC et à LUC. Le quatrième
établit les règles du "savoir-vivre"
fraternel dans la communauté chrétienne (chap.
18) et comporte quelques passages dont on ne
retrouve pas ailleurs la teneur (v. 10, 16-17,
19-20, 23-35). Le cinquième enfin traite de la
fin des temps et des fins dernières ; il enchâsse
également des séquences
"exclusives", notamment la parabole
"des Vierges sages et des Vierges
folles" (chap. 25, vers. 1-12) et le
morceau final sur le jugement dernier qui ouvre
ou refuse l'entrée du "Royaume" selon
les œuvres de chacun (chap. 25, vers 31-46). |
|
| |
. |
|
| |
Dans les sections narratives qui séparent ces discours (chap. 3 et 4 ;
chap. 8 à chap. 10, vers. 5 --- surtout consacrée
aux miracles ; chap. I1 et 12; chap. 13, vers.
53 à chap. 17; chap. 19 à 22), et qui dépendent
peut-être en bonne part de l'Évangile de MARC,
on relèvera notamment deux passages propres
encore à MATTHIEU: la parabole des deux fils
envoyés au travail (chap. 21, vers. 28-32) et
le complément dit "de la robe
nuptiale", à la parabole "des noces
royales" (chap. 22, vers. 11-14).
|
|
| |
A.
M. GÉRARD |
|
| |
. |
|
|
|
Les
images et les textes proviennent de : en ce temps là la
bible. Éditions
du Hennin Paris 1977
. |
|
|
|
| . |
|
Voici le meilleur Site pour former
et fortifier l'esprit.
Voici le meilleur Site
pour franchir La Porte du Ciel allègrement.
Que
l'Éternité doit être longue si nous la passons ailleurs qu'au «
Ciel »!
Ce
merveilleux endroit
que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, nous a
promis.
Papy
pour vous Servir
Haut de la page
œ
|
|
|